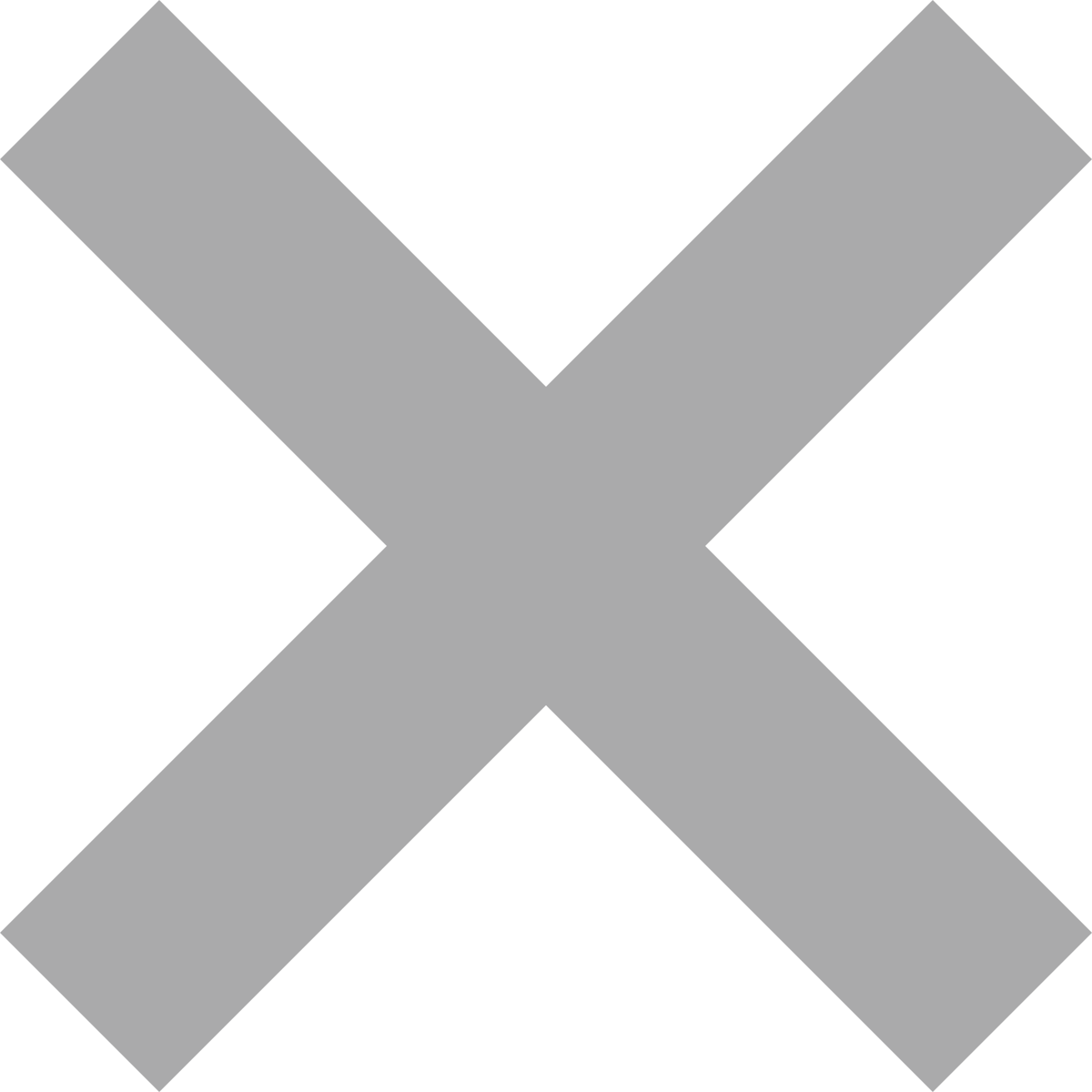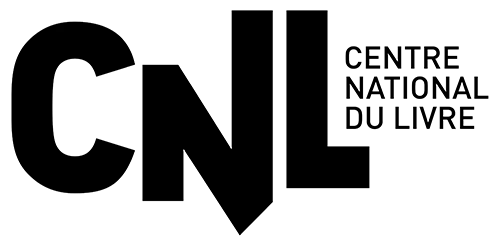mai 2022
978-2-8097-1508-8
18 €
160 pages
Lire Battre les cartes, c’est partir à la découverte du Shanghai des années cinquante à soixante-dix à travers les souvenirs de l’auteur qui y vit depuis toujours, une collection d’histoires vraies sur la chatoyante métropole du Sud où même les plus pauvres des mendiants dorment sous une couette en soie. Ce sont des années de grands bouleversements, on est recherché, envoyé à la campagne, on tente de sauver ses biens les plus précieux, cependant le printemps est toujours là, l’albizzia offre sa floraison somptueuse, les amoureux s’enlacent quand vient la nuit dans le salon de coiffure, par une pluie battante une boîte à biscuits remplie d’or traverse secrètement le fleuve… Ces récits nostalgiques de Shanghai, l’auteur les déroule avec un foisonnement de détails concrets qui nous font toucher du doigt les objets de la vie quotidienne et leurs métamorphoses au fil des années, et dans une langue subtile et sensuelle qui nous fait frémir et vibrer.
Le vent du sud traverse
la fenêtre ouest
La mer était balayée par des rouleaux grisâtres et viciés, sous un ciel bas noyé dans les brumes d’un hiver rigoureux. Je me tenais contre le bastingage du pont supérieur, et elle était là, à seulement quelques pas de moi. Le vent avait chassé l’écume répandue sur le pont pendant la nuit, le froid me mordait le visage.
1970. Je me trouvais à bord du Brocart éternel, à mi-chemin entre Shanghai et Dalian, et à la seule vue de cette veste de coton vert que tous portaient alors, j’avais compris qu’il s’agissait d’une jeune instruite. C’était la première fois qu’après être rentrés à Shanghai rendre visite à nos familles, nous repartions pour la Chine du Nord-Est.
Le bateau ralliait Shanghai au Nord de la Chine.
Petite, toute fluette, elle devait avoir dans les dix-huit, dix-neuf ans et portait les cheveux courts, avec une épaisse frange ; bien que l’époque fût aux vêtements à la couleur et au style uniformes, de légers détails dans notre mise trahissaient notre origine et notre destination. Quand ils se rencontraient, les jeunes instruits qui ne se connaissaient pas devinaient de quelle ville venait l’autre à la seule vue de sa tenue.
Après les directives de 1968 venues du plus haut sommet de l’Etat – lesquelles avaient forcé les jeunes instruits à partir travailler dans les campagnes –, les autorités de Shanghai avaient gratuitement fourni à ces masses de jeunes gens envoyés dans les provinces septentrionales des vêtements ouatés, uniformes quasi militaires de bonne qualité destinés à les protéger des rigueurs du froid. Ceux en partance pour le Heilongjiang s’étaient vu fournir quatre pièces vestimentaires : un manteau long, une casquette, une veste et un pantalon ; ceux en partance pour la province du Jilin n’en avaient reçu que trois : un manteau court, une casquette et un pantalon. Shanghai et sa région ne brillaient guère par la fabrication de ces habits d’hiver qui, en dépit de leur vert kaki, étaient d’une texture grossière et épaisse. Une fois arrivés dans le Nord, les jeunes gens du Sud enviaient les vêtements en grosse toile ouatée très seyants – semblables à des uniformes – des jeunes instruits venus de Pékin ou de Tianjin. A ceux qui vivaient déjà sur place, dans les froids rigoureux de Harbin, Qiqihar ou Mudanjiang, les autorités n’avaient pas jugé bon de fournir quoi que ce fût.
Cette jeune fille semblait attacher de l’importance à sa tenue. Sous sa veste molletonnée verte, elle portait une chemise chinoise bleu marine surmontée d’un faux-col jaune pâle, une mode alors populaire à Shanghai ; la fine laine tissée de ce faux-col formait une bande longue de quatre doigts, pourvue de boutons-pression à chaque extrémité, et il avait un usage décoratif tout en gardant le cou bien au chaud. Les yeux rivés sur l’océan, elle ignorait que je l’observais. Elle semblait voyager seule ; les quelques fois où j’étais descendu du pont avec des camarades, ou quand je m’étais entassé dans la grande cantine du bateau pour voir le film Lénine en 1918, j’avais également remarqué sa solitude : elle ne souriait jamais, ne parlait à personne, elle avait le regard profond et limpide.
Un jour où j’étais seul, je l’avais croisée dans une étroite coursive du bateau et elle avait eu un instant d’hésitation, attendant que je m’écarte sur le côté pour la laisser passer. Elle était toute gracile, et en se frôlant, nos vestes avaient soulevé un léger souffle d’air. J’avais remarqué son long pantalon noir en coton et polyester mélangés, parfaitement ajusté, les trois centimètres de survêtement sportif jaune pâle qui dépassaient au niveau de ses chevilles, ainsi que ses chaussures en chamois nouées par des lacets blancs de tennis Huili, alors très en vogue. Dans un film occidental, deux jeunes gens inconnus l’un à l’autre eussent sans doute éprouvé le désir de se parler… Mais nous nous croisâmes en silence, échangeâmes juste un regard aussi bref qu’un cliché Polaroid, ne conservant de la scène que quelques fragments, et cette brise légère.
Longtemps après, j’appris qu’un ami éditait une Histoire de la vie des citadins au temps de la Révolution culturelle, mais j’ignore si en plus d’avoir fait la moisson des très nombreux tickets d’approvisionnement qui avaient cours à cette époque, il s’est aussi intéressé aux détails qui caractérisaient les vêtements d’alors.
Au début des années 1970, la mode chez les jeunes Shanghaïens était aux pantalons serrés de grosse toile ; comme la pratique sportive était portée aux nues, tous les vêtements des jeunes Chinois comportaient des éléments ayant trait au sport. La dernière mode à Shanghai était d’enfiler les uns par-dessus les autres trois à cinq sweats à fermeture éclair et cols superposés. Les pantalons avaient l’élégance de celui qu’elle portait : serrés près du corps, ils mettaient à l’honneur le tissu en grosse toile noire ou grise, et au niveau des chevilles, le bas d’un survêtement dépassait sur trois à cinq centimètres, assorti à la couleur des chaussettes en nylon, le tout avec des tennis Huili blanches. Le summum du chic était de retirer les lacets et de retourner les languettes des tennis pour laisser voir la couleur toujours variée des chaussettes, chacun affirmant ainsi sa singularité. Très nombreux étaient les jeunes Shanghaïens qui avaient apporté avec eux ces particularités vestimentaires auxquelles les gens du Nord-Est
– jeunes et vieux confondus – se montraient hostiles : ils traitaient ces témoignages vivants du parfait mauvais goût de « racaille shanghaïenne », avec leurs pantalons « pattes-de-poulet » et leurs « petits souliers blancs ». En vérité, pour les jeunes gens branchés de Harbin, la mode était aux chaussures montantes en peau de chamois et à ces atroces pantalons militaires aux jambes larges, pour la bonne raison qu’en hiver, ils pouvaient enfiler en dessous un caleçon ouaté et qu’en été, ils pouvaient ne porter que le pantalon. Chez eux, le petit détail à la mode était de mettre à leurs chaussures des lacets blancs de tennis Huili ; façon de suggérer la richesse, car s’il fallait dépenser une fortune pour avoir des Huili, il était bien plus simple d’acheter une paire de lacets.